349 – La loi de 2011 sur la sécurité sanitaire renforce le contrôle sur les Dispositifs Médicaux (DM). D’autres évolutions sont annoncées à la suite de l’affaire des prothèses mammaires, notamment la création d’une AMM pour certains produits. Les médecins comme les industriels souhaitent que ces évolutions n’empêchent pas les patients de bénéficier rapidement de dispositifs innovants.
Parce qu’elle est étroitement liée à l’affaire du Médiator, la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire a surtout été commentée du point de vue du seul domaine de la pharmacie. Mais la « loi Bertrand » ne concerne pas que les médicaments, elle concerne également de vastes domaines des DM. Vaste domaine, puisque l’on recense quelque 4 000 classes de DM représentant environ 800 000 produits, qui vont de la simple compresse au scanner, en passant par le lit médicalisé et les dispositifs implantables, prothèses en tout genre, stents, défibrillateurs et autres prothèses valvulaires cardiaques… Tous ces produits sont classés en fonction de leur niveau de risque (durée d’implantation, délai de détérioration, etc.) dans quatre classes : niveaux 1, 2A, 2B et niveau 3 (le plus haut risque). Pour cette dernière catégorie, depuis 2000, une évaluation clinique est obligatoire, dont l’exigence a été renforcée en 2010.
Pas d’AMM pour les dispositifs médicaux
Mais pour l’ensemble des DM, leur mise à disposition ne passe pas, comme pour le médicament, par une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), mais par l’obtention du marquage CE délivré par des organismes certifiés désignés par les différents Etats. Nantis du marquage CE, les DM passe par l’AFSSAPS – devenue Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) par la loi – qui les évalue du point de vue de la matériovigilance. Il revient ensuite à la Commission Nationale d’Evaluation de DIspositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDIMTS) de la Haute Autorité de Santé d’en faire l’évaluation scientifique en vue de leur remboursement. Jusqu’à présent, la HAS n’évaluait pas les DM relevant d’un financement dans les groupes homogènes de séjour. Elle devra le faire à l’avenir conformément à la loi de décembre 2011. La CNEDIMTS devra aussi remettre chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’Assurance Maladie.
Une publicité soumise à autorisation
Comme la publicité sur les médicaments, la publicité pour les dispositifs médicaux est strictement encadrée par la loi. En particulier, pour les DM « présentant un risque important pour la santé humaine » et dont la liste sera établie par le Ministère de la Santé, la publicité est désormais soumise à une autorisation préalable délivrée par l’ANSM pour une durée de cinq ans renouvelable. Le même dispositif s’applique aux DM de diagnostic in vitro « dont la défaillance est susceptible de causer un risque grave pour la santé ».
La loi de décembre dernier instaure également que l’ANSM puisse faire procéder à un contrôle de conformité des DM aux spécifications techniques requises pour l’inscription sur la liste des produits remboursables. Elle autorise aussi le contrôle par des agents assermentés de l’Assurance Maladie de la conformité des DM aux règles de facturation et de tarification en vigueur.
Enfin, la loi dit que l’ANSM doit remettre au Parlement avant le 30 juin prochain « un rapport dressant le bilan des règles applicables à la sécurité des dispositifs médicaux et présentant des règles susceptibles de l’améliorer ».
Un système de sécurité sanitaire mis sur la sellette
A peine l’affaire du Médiator quittait-elle les feux de l’actualité que l’affaire des prothèses mammaires PIP faisait la Une des médias au début de l’année. Certes, il faut rapidement établir que l’on était ici en présence d’une fraude manifeste de la part d’un fabricant que les scrupules et le souci de la santé des patientes n’étouffent pas, c’est le moins que l’on puisse dire. N’importe, l’opinion publique ne pouvait s’empêcher de se demander comment une telle fraude avait pu perdurer des années et, une fois encore, notre système de sécurité sanitaire était mis sur la sellette.
Un premier rapport de l’AFSSAPS et de la DGS remis au Ministre de la Santé a avancé un certain nombre de recommandations pour renforcer le contrôle des dispositifs médicaux. La première vise un renforcement des inspections par l’AFSSAPS. Mais de nombreux produits étant fabriqués à l’étranger, une coopération entre les agences des différents pays est souhaitable. Renforcer les inspections signifie surtout effectuer des inspections inopinées et régulières, qui ne permettent pas à d’éventuels fraudeurs de cacher leurs méfaits. Un laboratoire européen pourrait être chargé de l’analyse des produits qui seront prélevés lors de ces inspections inopinées. La matériovigilance nécessite elle aussi la coopération entre les différents Etats.
Une volonté de réformer la réglementation
Dans le cadre de la révision de la directive européenne sur les DM, la France propose la mise en place d’une procédure de centralisation de signalements et de traitement des incidents recueillis par chaque autorité nationale ; les fabricants seraient dans l’obligation de déclarer dans chaque Etat membre des signalements faits par les professionnels de santé.
Dès la remise de ce rapport, Xavier Bertrand a fait part de sa volonté de réformer la réglementation, souhaitant notamment la mise en place d’une AMM pour les DM. Le directeur général de l’AFSSAPS, Dominique Maraninchi, estime que les autorités européennes devraient engager cette réforme, jugeant le système de contrôle par des organismes certificateurs insuffisant. Ils ont été entendus, puisque Guido Rasi, le nouveau directeur de l’Agence européenne du médicament (EMA), s’est prononcé en faveur d’un renforcement de la réglementation européenne sur les DM, jugeant qu’il était urgent « de prendre pour le matériel médical les mêmes mesures de sécurité que pour les médicaments ».
Chez les professionnels de santé comme chez les industriels du secteur, le renforcement de la sécurité sur les dispositifs médicaux, s’il est accueilli plutôt favorablement, ne va pas sans susciter quelques craintes. La principale est que l’accroissement des contrôles et des évaluations ne soit un frein à l’innovation et ne retarde la mise à disposition de matériels qui, jusqu’à ce jour, ont sauvé plus de vies qu’ils n’en n’ont compromis.
Le champ évaluatif de la HAS est élargi
La mission d’évaluation des DM de la HAS est étendue par la loi aux dispositifs de prescription hospitalière.
La loi de renforcement de la sécurité sanitaire accroît l’intervention de la Haute Autorité de Santé dans le domaine des dispositifs médicaux. « Jusqu’à présent, le rôle de la Haute Autorité de Santé dans le domaine de dispositifs médicaux est de procéder à leur évaluation scientifique en vue de leur remboursement par l’Assurance Maladie, explique Jean-Michel Dubernard, membre du Collège de la HAS et président de la CNEDIMTS. Il s’agit donc de déterminer le niveau de service médical rendu ou d’amélioration du service médical rendu. La loi de décembre 2011 n’apporte qu’une modification concernant la HAS, mais elle est d’une importance considérable, puisqu’elle lui confie désormais l’évaluation des dispositifs médicaux relevant d’un financement dans les groupes homogènes de séjour (GHS). » La liste des produits concernés sera établie par les ministres en charge de la santé et de la Sécurité Sociale. L’inscription des produits sur la liste est prononcée pour une durée déterminée et renouvelable. Les établissements de santé qui achèteront ou utiliseront des produits non inscrits sur cette liste seront passibles d’une sanction financière prononcée par l’ARS.
« Jusqu’à présent, ne passaient par la CNEDIMTS que les dispositifs inscrits sur la liste des prescriptions remboursables dite “liste en sus”, précise Catherine Denis, chef du service d’évaluation des dispositifs (SED). Les dispositifs de ville à usage individuel passent également par la HAS, ainsi que les dispositifs jamais évalués liés à un acte, pour lesquels c’est l’UNCAM qui décide du remboursement. Mais nous ne nous occupions pas des DM remboursés dans le cadre de la prescription hospitalière. Nous allons le faire désormais, et c’est un travail énorme qui ne pourra se faire à moyens constants. »
Actuellement, la HAS traite plus de 150 dossiers par an. « En plus de ces 150 dossiers, nous procédons également à la révision de six à huit catégories de dispositifs par an, précise Catherine Denis. Les stents ou les défibrillateurs, par exemple, constituent des catégories qui doivent être révisées tous les cinq ans. »
En dehors de cette extension de son rôle par la loi, la HAS n’est a priori pas concernée par les évolutions annoncées par Xavier Bertrand à la suite de l’affaire des prothèses PIP. Mais Jean-Michel Dubernard voit favorablement le renforcement du système annoncé. « Une révision de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux est prévue en 2012 avec l’ensemble des parties prenantes. Il va y avoir un accroissement des exigences en matière de données cliniques, et ce sera bénéfique pour les patients. Nous aurons des dossiers plus complets qui nous permettront de voir sur quoi les organismes notifiés se sont appuyés pour délivrer le marquage CE. La loi de décembre 2011 et les évolutions à venir vont dans le sens de ce que, en tant que président de la CNEDIMTS, j’ai toujours souhaité. »
C’est dans cet esprit que la HAS a conçu un guide pédagogique pour l’établissement des dossiers de demande à la CNEDIMTS d’inscription d’un produit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), et qu’elle organise chaque année des journées d’information pour les fabricants. « Notre objectif à travers ces journées, explique Catherine Denis, est que leurs dossiers soient de meilleure tenue, du point de vue de la qualité du produit et non pas seulement de son descriptif. »
Entretien Philippe Mabo
« Un équilibre est à trouver pour ne pas freiner l’innovation »
Pour Philippe Mabo, cardiologue au CHU de Rennes et président du groupe rythmologie de la FFC, le renforcement de la sécurité sanitaire ne doit pas entraver l’innovation dans le domaine des dispositifs médicaux.
Quelles évolutions peut-on attendre en cardiologie concernant les dispositifs médicaux ?
Philippe Mabo : Tout d’abord, et concernant la cardiologie, je tiens à souligner que la décision récente de la HAS de ne pas étudier le dossier du remboursement de l’acte associé au télésuivi des prothèses avant 2013 donne un coup de frein à cette pratique. Nous sommes actuellement dans une situation paradoxale : les industriels perçoivent un bonus, c’est-à-dire un tarif plus élevé si le télésuivi est associé au DM, mais où le médecin, lui, ne perçoit rien s’il active cette fonction ! Nous l’avions dit, il fallait traiter le dossier de façon globale. On a fait beaucoup de bruit autour de la loi sur la télémédecine, mais lorsqu’il s’agit d’entrer dans le vif du sujet, c’est autre chose. Manifestement, avec la généralisation du télésuivi, les tutelles redoutent d’être confrontées à un problème de coût, et elles ont peur d’ouvrir la boîte de Pandore. Mais la communauté cardiologique est très raisonnable ; elle est prête à accepter un forfait, et les risques de dérapages peuvent être encadrés. Le but du télésuivi n’est pas de faire des économies, mais une amélioration qualitative pour le patient, sans surcoût pour le système de santé.
Sur le plan technologique, les appareils sans sonde qui vont bientôt entrer en évaluation clinique, et les prothèses multifonctions sont parmi les évolutions majeures à venir. Une autre grande évolution sera la neurostimulation dans l’insuffisance cardiaque ou la HTA. Cette technique complémentaire aux médicaments, qui consiste à stimuler le nerf vagal ou spinal pour agir sur la balance vagotonique, n’en est encore qu’à un stade très préliminaire et tout le travail reste à faire, mais cela devrait déboucher dans les années qui viennent.
Comment appréhendez-vous l’impact de la loi de renforcement de la sécurité sanitaire sur les DM ?
Ph. M. : Le durcissement dans les processus d’évaluation des DM auquel on peut s’attendre va augmenter les coûts pour les industriels et rallonger le délai de développement des produits. On peut donc craindre que cela soit un frein à l’innovation. Avec l’intégration des DM dans les GHS, tout établissement de santé pouvait acheter un produit au prix proposé. Nous avions mis en garde les autorités sur le fait que le marquage CE ne validait qu’une évaluation technologique. La loi de décembre 2011 remet en place un processus d’études cliniques pour les DM inclus dans les GHS afin d’en valider le SMR ou l’ASMR. Sachant que la durée minimum d’une étude clinique est de trois ans et que le turn-over des DM est de trois ans également, un produit risquera d’être mis à disposition dans sa version V1 au moment même où sa version v2 sera annoncée ! On risque de perdre le temps d’une génération de produit. Aujourd’hui, il faudrait cinq ou six ans d’étude cliniques pour que la resynchronisation cardiaque soit effective… L’augmentation des coûts peut aussi faire redouter un impact sur l’activité de recherche clinique des équipes, les industriels risquant de se montrer plus frileux pour les accompagner dans leurs projets.
Selon vous, la loi risque donc d’avoir des effets plus néfastes que bénéfiques ?
Ph. M. : Non, la loi est potentiellement bénéfique, sous réserve qu’on ne soit pas plus royaliste que le roi, qu’on ne passe pas d’un extrême à l’autre, mais qu’on place le balancier au bon endroit. Il faut éviter d’entraver l’innovation, et de voir les études nous échapper pour aller se faire vers l’Est ou en Chine, dans des pays aux réglementations plus laxistes. n
Entretien Eric Le Roy
« Le renforcement de la sécurité ne doit pas paralyser nos industries »
Directeur général du SNITEM, Eric Le Roy, met en garde contre une évolution de la réglementation en matière de DM qui retarderait la mise sur le marché de produits innovants et pénaliserait du même coup les patients.
Quelles sont les conséquences de la loi de renforcement de la sécurité sanitaire sur le secteur des dispositifs médicaux ?
Eric Le Roy : Il importe en préambule de souligner l’extrême diversité de ce marché qui va de la compresse au lit médicalisé en passant par les dispositifs implantables. Certains DM sont diffusés à des millions d’exemplaires, d’autres en quantité beaucoup plus limitée. Par exemple, on pose moins d’un millier de prothèses valvulaires percutanées par an en France. A cette diversité des produits répond une diversité de conception et de fabrication faisant appel à des industries et à des métiers très divers également. Les réglementations de 1990, puis de 1998 sont adaptées à cette diversité, et la marquage CE tient compte de ces éléments. Ce marquage spécifique aux DM se fait selon des normes harmonisées spécifiques. Le réseau de référentiels est relativement complet et couvre tous les secteurs.
Concernant la loi de décembre 2011, la « loi Bertrand », il est difficile d’en mesurer l’impact pour nos entreprises avant la parution des décrets d’application. On sait que la loi instaure la création de listes de certains produits pour lesquels il y aura un contrôle de la publicité a priori par l’AFSSAPS. Elle introduit également une évaluation par la HAS des produits inclus dans les GHS. Nous serons vigilants à ce que ces nouvelles règles ne viennent pas bloquer l’arrivée sur le marché et donc la mise à disposition des patients de produits innovants.
Vous redoutez l’augmentation des délais du fait de ces évaluations ?
E. L R. : Je ne veux pas partir de l’idée que le temps d’évaluation sera long, et je compte sur l’intelligence des politiques et des organismes de contrôle pour que le délai d’accès aux produits ne soit pas rallongé. La loi est une loi de renforcement de la sécurité, elle ne doit pas être une loi de blocage. Quant à la transparence à toutes les étapes introduite par la loi, elle doit être simple à mettre en place. Il ne faut pas tomber dans une hyperadministration qui pénaliserait les nombreuses PME de notre secteur qui n’auront pas les moyens d’embaucher des personnels spécialisés pour la gérer.
A la suite de l’affaire des prothèses mammaires PIP, le Ministre de la santé, Xavier Bertrand, a annoncé un certain nombre de propositions pour renforcer le contrôle sur le DM, notamment la création d’une AMM comme pour les médicaments. Qu’en pensez-vous ?
E. L R. : L’affaire des prothèses PIP est une affaire de fraude qui relève de la justice. Comment débusquer la fraude ? Il appartient aux agences d’agrément d’agir par des inspections les plus efficientes possible. En France, c’est le rôle régalien de l’AFSSAPS, et je n’ai pas de commentaire particulier à ajouter à ce sujet. Concernant l’hypothèse d’une AMM pour les DM, je tiens à souligner que depuis 1998, la réglementation a évolué au moins cinq fois. Les produits de classe 3 à plus haut niveau de risque, notamment tous les dispositifs implantables, ont toujours fait l’objet d’une évaluation clinique, qui a été renforcée depuis 2000. Une nouvelle évolution de la réglementation est possible, mais il importe qu’elle ne marque pas l’arrêt de nos entreprises. C’est une question de « hauteur de marche » en quelque sorte. Le plus important pour nous est que toute évolution se passe au niveau européen. Oui, la collaboration entre les agences européennes doit être renforcée et des efforts sont à faire pour améliorer la communication entre elles. De même, la matériovigilance doit être renforcée et se faire via un portail européen. Si l’on passe par 27 portails nationaux, on se retrouvera à nouveau un jour ou l’autre avec un problème consécutif à une coordination défaillante. Notre préoccupation majeure est que les patients français ne soient pas pénalisés en matière de DM par rapport aux autres patients européens.

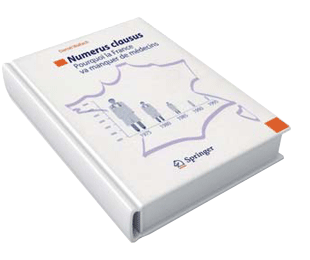 (gallery)
(gallery)
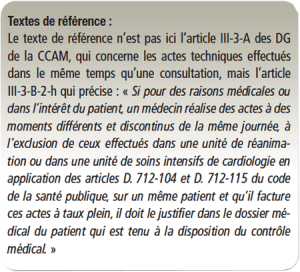
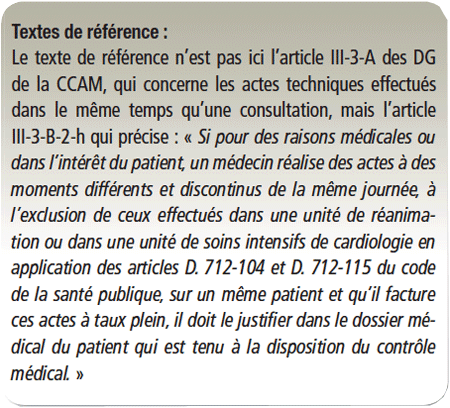 (gallery)
(gallery)

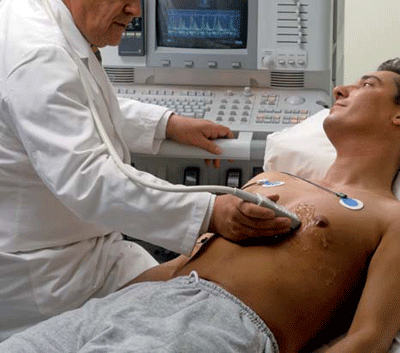 (gallery)
(gallery)