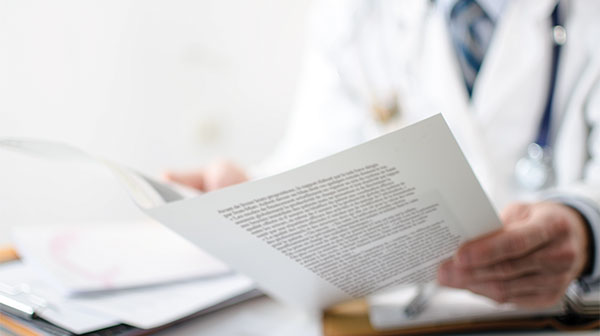La pertinence des soins est désormais incontournable


L’Assurance-maladie, pilier du système social français, est confrontée à un déficit croissant et durable qui s’est établi à 13,8 milliards d’euros en 2024, contre 11,1 milliards en 2023. Les hôpitaux publics, eux, ont vu leur déficit grimper à 3,5 milliards d’euros la même année.
Nathalie Zenou – Le Cardiologue 462 – septembre-octobre 2025 – © Depositphotos – Depositedhar
Au-delà de la conjoncture, c’est une tendance structurelle qui inquiète : le vieillissement de la population, la progression continue des pathologies chroniques, mais aussi des pratiques médicales parfois peu efficientes.
Dans ce contexte, le rapport 2025 de l’Assurance-maladie, préparatoire au projet de loi de financement (PLF) 2026, fait de la pertinence des soins un axe majeur.
L’objectif est double : améliorer la qualité des soins délivrés et maîtriser les dépenses en évitant le recours à des actes ou prescriptions sans valeur ajoutée pour le patient.
Focus chiffré : poids des pathologies chroniques
- En 2035, un Français sur quatre sera en affection de longue durée (ALD).
- Ces patients concentreront trois quarts des dépenses de l’Assurance-maladie.
- Entre 2015 et 2023, 71 % de la croissance des dépenses de santé provenait de la hausse des dépenses liées aux pathologies chroniques.
La déprescription et la lutte contre le mésusage médicamenteux
La prescription médicale constitue l’un des piliers de la pratique clinique. Pourtant, elle est aussi l’une des principales sources de dépenses et de mésusage.
L’Assurance-maladie identifie trois dérives majeures :
-
- Le maintien prolongé de traitements devenus inutiles, notamment en gériatrie où la polymédication expose à un risque iatrogène élevé.
- Les prescriptions redondantes, lorsqu’un traitement est reconduit sans réévaluation périodique.
- Le recours excessif à certaines classes thérapeutiques en l’absence de justification clinique solide.
La déprescription : une exigence thérapeutique
La déprescription est présentée comme un axe prioritaire. Elle vise à interrompre un traitement devenu superflu ou délétère pour le patient. Ce n’est pas un retrait brutal, mais une démarche progressive, structurée, fondée sur le dialogue médecin-patient et appuyée par des recommandations scientifiques.
L’Assurance-maladie propose de :
-
- Développer des revues thérapeutiques régulières, en particulier pour les patients âgés et polymédiqués.
- Inciter à la déprescription via des outils d’aide à la décision intégrés aux logiciels médicaux.
- Valoriser la déprescription dans les mécanismes de financement incitatifs (comme les expérimentations de type « article 51 »).
Focus chiffré : médicaments et économies potentielles
- Entre 2011 et 2019, la croissance des remboursements de médicaments a été limitée à +0,6 % par an grâce aux politiques de régulation.
- Le développement des génériques et biosimilaires pourrait générer des économies supplémentaires dès 2026, tout en maintenant la qualité des soins.
- Le rapport chiffre à plusieurs milliards d’euros les gains possibles liés à une meilleure pertinence dans la prescription et l’usage des médicaments.
LA PERTINENCE MÉDICAMENTEUSE ne consiste pas à restreindre l’accès aux traitements, mais à en garantir l’usage approprié. La déprescription est un acte clinique à part entière, qui nécessite formation, outils adaptés et valorisation. Elle permet de réduire les dépenses inutiles et de sécuriser le parcours des patients.
Le numérique comme garant de la pertinence
Du dossier médical partagé à l’ordonnance numérique
Le numérique est présenté par l’Assurance-maladie comme un levier incontournable pour améliorer la pertinence des soins.
Le Dossier Médical Partagé (DMP), pourtant déployé depuis plusieurs années, reste encore sous-utilisé. Le rapport propose d’en faire un outil obligatoire, en conditionnant certains remboursements à son alimentation effective, en particulier pour les examens de biologie et de radiologie.
L’objectif est clair : éviter les redondances, améliorer la coordination entre ville et hôpital et réduire les actes inutiles. À terme, l’ambition est d’inscrire chaque interaction médicale dans un continuum numérique cohérent et traçable.
Ordonnance numérique : sécuriser les prescriptions sensibles
L’Assurance-maladie fixe une perspective ambitieuse : d’ici 2030, toutes les prescriptions onéreuses ou sensibles devront être délivrées sous forme d’ordonnance numérique.
Ce dispositif répond à plusieurs enjeux :
- Traçabilité totale des prescriptions, de l’émission à la délivrance.
- Réduction des fraudes liées aux falsifications d’ordonnances papier.
- Sécurisation des parcours grâce à un meilleur suivi des traitements.
- Contrôle renforcé des prescriptions les plus coûteuses, permettant une régulation en temps réel.
Intelligence artificielle et aide à la décision médicale
Le rapport va plus loin en recommandant le recours généralisé aux outils numériques d’aide à la prescription et à la décision, intégrant les technologies d’intelligence artificielle (IA).
Ces outils de nouvelle génération devraient :
- Fournir des alertes en temps réel sur les interactions médicamenteuses ou les contre-indications.
- Proposer des alternatives thérapeutiques validées.
- Comparer les pratiques du médecin avec les référentiels nationaux et les données de ses pairs.
- Être obligatoires pour certaines spécialités ou prescriptions sensibles.
Une révolution dans la pratique clinique
Pour les médecins, ces dispositifs numériques représentent un changement profond :
- Ils transforment l’acte de prescription en un processus plus transparent et contrôlé.
- Ils modifient la relation au patient en facilitant le partage d’informations et l’éducation thérapeutique.
- Ils réduisent le risque d’iatrogénie en renforçant la sécurité des parcours.
➤ L’outil numérique n’est pas une contrainte mais un allié clinique, permettant de concilier pertinence médicale et maîtrise collective des dépenses.
Former et accompagner les médecins
Retour d’expérience et auto-régulation des pratiques
Le rapport souligne que la pertinence des soins ne pourra progresser sans un investissement massif dans la formation continue des professionnels de santé. Trop souvent, les écarts de pratiques proviennent moins d’un défaut de volonté que d’un manque de mise à jour des connaissances ou d’un défaut de sensibilisation aux enjeux médico-économiques.
L’Assurance-maladie propose ainsi que, à différents stades de la carrière, chaque médecin conventionné bénéficie de sessions obligatoires portant sur :
- les dispositifs de facturation,
- les recommandations de bonnes pratiques,
- l’évaluation de la pertinence des actes,
- les outils numériques de suivi et de prescription.
Cette logique vise à inscrire la pertinence dans le quotidien clinique, en faisant du savoir actualisé un prérequis de l’exercice médical.
Le retour d’information entre pairs
Au-delà de la formation académique, le rapport insiste sur la force de l’auto-régulation professionnelle. L’Assurance-maladie souhaite développer des dispositifs de feedback comparatif : chaque médecin recevrait régulièrement des données anonymisées lui permettant de situer sa pratique par rapport à celle de ses pairs.
Objectifs :
- Identifier rapidement des écarts de prescription ou d’actes.
- Favoriser une prise de conscience sans passer par la sanction.
- Valoriser les bonnes pratiques et encourager l’amélioration continue.
Ce retour d’information serait adapté aux différentes spécialités, avec un accent particulier sur la biologie, la radiologie et la prescription médicamenteuse.
Vers une culture de la pertinence partagée
Le rapport propose également de développer la culture médico-économique des praticiens. Il ne s’agit pas seulement de prescrire selon l’état de l’art, mais aussi de comprendre l’impact financier des décisions médicales sur l’équilibre global du système.
Ainsi, chaque assuré devrait recevoir un état des dépenses investies par l’Assurance-maladie pour ses soins. Cette transparence, partagée avec les professionnels, renforcerait la prise de conscience des enjeux collectifs.
FORMER ET ACCOMPAGNER LES MÉDECINS permet de leur donner les moyens de faire évoluer leurs pratiques en phase avec les données scientifiques et les impératifs collectifs. Le retour d’expérience entre pairs, la formation continue et la diffusion d’une culture médico-économique partagée constituent les trois piliers d’une régulation par et pour les professionnels.
Responsabiliser les établissements et les patients
Les établissements de santé au cœur de la régulation
La pertinence des soins ne peut pas reposer uniquement sur les prescriptions individuelles des médecins libéraux. Le rapport met l’accent sur la responsabilité des établissements hospitaliers et cliniques, dont les pratiques impactent directement les dépenses de ville. Les Prescriptions Hospitalières Exécutées en Ville (PHEV), souvent coûteuses, représentent par exemple une part croissante de la dépense ambulatoire. Or, leur pertinence est très variable selon les services et les établissements.
Pour agir, l’Assurance-maladie propose de :
- Créer un dispositif d’intéressement : les établissements qui réduisent les prescriptions inutiles ou redondantes en ville partageront les économies réalisées.
- Mettre en place des outils de suivi renforcés pour tracer l’origine et la justification des PHEV.
- Associer les établissements à la régulation des transports sanitaires, par exemple en transférant aux centres de dialyse la gestion du budget des transports de leurs patients.
Un financement hospitalier orienté vers la pertinence
Le rapport préconise une réforme du financement hospitalier pour rompre avec la logique de volume qui domine encore certains segments de la tarification à l’activité (T2A), afin de privilégier la qualité et la pertinence des prises en charge :
- Introduire une part variable indexée sur la qualité et la pertinence des soins, pouvant atteindre 10 % de l’enveloppe budgétaire des établissements (sur le modèle de la ROSP pour les médecins libéraux).
- Encourager la chirurgie ambulatoire et d’autres pratiques efficientes, déjà identifiées comme sources importantes d’économies.
- Revoir le financement de l’activité libérale des praticiens hospitaliers, afin de l’aligner sur les objectifs de pertinence.
Les patients, acteurs de la pertinence
La pertinence ne peut pas être uniquement une affaire de soignants et d’établissements : les patients eux-mêmes doivent devenir acteurs de leur parcours.
Le rapport recommande :
- De renforcer l’information des assurés en leur restituant le coût réel des soins consommés.
- De développer des campagnes pédagogiques sur le thème du « juste soin » : un acte médical inutile n’est pas neutre, il peut comporter des risques et mobiliser des ressources précieuses.
- D’impliquer davantage les patients dans la décision thérapeutique, en favorisant la transparence et le dialogue médecin-patient.
TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION. Une proposition emblématique du rapport consiste à restituer à chaque assuré un relevé des dépenses réellement prises en charge par l’Assurance-maladie pour ses soins. Objectif : rendre tangible l’investissement collectif et responsabiliser les patients face à l’usage du système de santé.
Les propositions phares du rapport pour 2026
Un ensemble structuré de mesures
Le rapport de l’Assurance-maladie 2025 propose une série de propositions concrètes pour améliorer la pertinence des soins. Ces mesures constituent une feuille de route pour 2026. Regroupées autour de cinq axes, elles touchent l’ensemble du système.
1. Pertinence des prescriptions
- Proposition 40 : développer la déprescription – généraliser les démarches de révision thérapeutique, en particulier pour les patients âgés polymédiqués.
- Proposition 27 : instaurer un mécanisme de financement partagé des essais de désescalade thérapeutique en oncologie, impliquant laboratoires et Assurance-maladie.
- Proposition 49 : revoir la tarification de la PPC dès 2026 pour l’aligner sur les standards internationaux.
- Proposition 28 : augmenter les économies liées aux génériques et biosimilaires en facilitant leur substitution et en garantissant leur qualité.
2. Numérique et sécurisation des prescriptions
- Proposition 39 : usage systématique du DMP, avec minorations tarifaires en cas de non-alimentation, notamment pour la biologie et la radiologie.
- Proposition 41 : rendre obligatoires les outils numériques d’aide à la prescription et à la décision, intégrant intelligence artificielle et recommandations actualisées.
- Proposition 42 : généraliser l’ordonnance numérique d’ici 2030, en priorité pour les prescriptions sensibles et onéreuses.
3. Financement hospitalier et régulation des établissements
- Proposition 45 : intéressement des établissements sur les PHEV – les hôpitaux partageront les économies réalisées en réduisant les prescriptions inutiles en ville.
- Proposition 46 : intégrer une part variable de financement basée sur la qualité et la pertinence – objectif de 10 % de l’enveloppe hospitalière, sur le modèle de la ROSP.
- Proposition 47 : transférer aux établissements de santé le budget des transports de certains patients (dialyse) pour responsabiliser les structures.
- Proposition 48 : revoir le financement de l’activité libérale des praticiens hospitaliers pour aligner incitations et pertinence.
4. Responsabilisation des professionnels de santé
- Proposition 37 : développer le retour d’information aux médecins sur leurs pratiques pour favoriser l’auto-régulation.
- Proposition 38 : formation continue obligatoire aux enjeux de pertinence et de facturation à différents stades de carrière.
- Proposition 51 : réguler l’installation des infirmiers libéraux avec un mécanisme de quotas en zones surdotées (« deux départs pour une installation »).
- Proposition 52 : conditionner le tiers payant à l’utilisation systématique de la carte Vitale, sauf exceptions.
- 5. Information et implication des patients
- Proposition 36 : campagnes de communication sur l’investissement public en santé (coût d’un accouchement, d’une nuit à l’hôpital, etc.).
- Proposition 56 : renforcer l’information des assurés et le suivi des patients atypiques pour limiter les recours injustifiés.
- Proposition 59 : réunir toutes les parties prenantes afin de stabiliser la part financée par l’Assurance-maladie obligatoire à 80 %.
Focus chiffré : potentiel d’économies
- Les mesures de pertinence proposées pour 2026 visent un objectif inédit : 3,9 milliards d’euros d’économies documentées dès la première année.
- À horizon 2030, il faudra 25 milliards d’euros d’économies cumulées pour stabiliser la trajectoire financière de l’Assurance-maladie.
- La pertinence des soins représente donc l’un des principaux leviers, avec la prévention et la lutte contre les rentes économiques.
Focus spécialité : la cardiologie face au défi de la pertinence
Des pathologies lourdes et coûteuses
La cardiologie concentre une part importante des dépenses de l’Assurance-maladie, en raison du poids des MCV dont la prise en charge repose sur un ensemble complexe : médicaments chroniques (antihypertenseurs, anticoagulants, statines), examens (échographies cardiaques, IRM, coronarographies) et interventions lourdes (angioplasties, pontages).
Ces pathologies, souvent chroniques et invalidantes, participent fortement à la croissance des dépenses de santé. La pertinence des soins en cardiologie devient donc un enjeu à la fois médical et économique.
Variations de pratiques et actes redondants
Le rapport met en évidence :
- des variations territoriales marquées dans le recours à certains actes diagnostiques (imagerie, bilans biologiques de suivi),
- des examens redondants réalisés sans coordination entre hôpital et ville,
et une progression rapide des prescriptions de dispositifs coûteux comme les stimulateurs ou défibrillateurs implantables.
Ces écarts traduisent des pratiques hétérogènes, parfois éloignées des recommandations, et créent une source d’inefficience.
Apports du numérique et de la coordination
Le rapport souligne que la cardiologie pourrait bénéficier de manière prioritaire :
- de l’usage obligatoire du DMP pour tracer prescriptions et examens,
- de l’ordonnance numérique pour les anticoagulants et les dispositifs médicaux coûteux,
- de l’aide à la décision par IA pour harmoniser les indications d’imagerie et de traitements prolongés.
Ces outils doivent permettre de réduire les écarts de pratiques et de renforcer la sécurité des parcours, notamment dans les pathologies chroniques comme l’insuffisance cardiaque.
PERTINENCE EN CARDIOLOGIE – LES POINTS-CLÉS
Anticoagulants oraux : nécessité d’un suivi rigoureux pour éviter la surprescription ou la poursuite de traitements sans indication claire.
Statines : prescriptions parfois maintenues sans réévaluation périodique, alors que l’efficacité dépend fortement du profil de risque du patient.
Imagerie cardiaque : IRM et échographies répétées sans coordination peuvent générer des doublons coûteux.
Dispositifs implantables : importance d’un encadrement strict des indications pour garantir un rapport coût/efficacité optimal.
Rééducation et suivi post-infarctus : un levier majeur de pertinence, trop souvent sous-utilisé par rapport à ses bénéfices cliniques avérés.
Le Syndicat national des cardiologues peut vous aider à chacune de ces étapes !